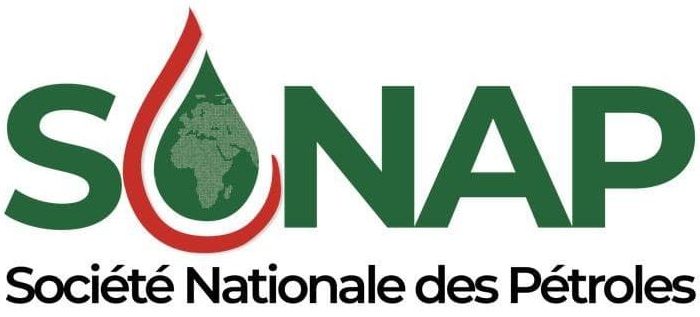Historique du secteur pétrolier aval
Pendant la période coloniale, le secteur pétrolier guinéen se limitait exclusivement à la distribution des produits pétroliers raffinés : essence, pétrole, jet, gaz butane, gasoil et fuel oil.
Les activités d’importation, de stockage et de distribution de produits pétroliers étaient l’apanage d’une multitude de sociétés filiales de grandes compagnies internationales : SHELL, TEXACO, MOBIL, TOTAL, B.P. etc., et chacune de ces sociétés fixait son prix dans un esprit de concurrence.
L’appontement pétrolier du port de Conakry servait au déchargement des navires, et les produits étaient stockés dans des bacs construits à cet effet à environ 1,5 km de l’installation de déchargement. La capacité de ce dépôt construit par la société African Pétroleum Terminal (APT) était de 40 000 m3, tous produits confondus.
En plus de ce dépôt principal, il existait deux dépôts relais à Mamou de 1800 m3 et à Kankan de 2400 m3.
Le réseau de distribution comptait 130 stations-service reparties sur l’ensemble du territoire.
Apres l’accession du pays à la souveraineté nationale, et l’affirmation de l’option socialiste du régime, la 1ère République a procédé à la nationalisation des activités et des infrastructures de distribution des produits pétroliers et a en confier le monopole à une entreprise d’Etat créée à cet effet en 1961 : l’Office National des Hydrocarbures (ONAH).
Cette Entreprise avait l’exclusivité sur toute la chaîne de distribution du carburant : Importation, stockage, transport et vente à travers un réseau de stations-service implantées sur l’ensemble du territoire national et dont elle avait la gestion directe.
Ainsi sous la 1ère République, le secteur pétrolier aval guinéen avait la configuration suivante :
1. Une Entreprise nationale ayant le monopole de l’importation, du stockage, du transport et de la distribution des hydrocarbures ;
2. Un dépôt de stockage portuaire : African Petroleum Terminal (APT) propriété de TEXACO puis de la SGE (Société Guinéenne d’Entreposage) co propriété de SHELL (2/3) et de TOTAL (1/3);
3. Deux dépôts ferroviaires de stockage : à Mamou et à Kankan approvisionnés à partir de Conakry par chemin de Fer, puis par camions citernes.
4. Deux cent cinq (205) stations-service à Conakry et dans toutes les préfectures dont ONAH avait la propriété et la gestion.
Pendant toute la durée de la gestion étatique de ce secteur, il n’y a pas eu un développement remarquable du réseau de distribution. Le manque d’entretien a aussi entrainé la dégradation des installations existantes.
L’élaboration du plan triennal 1961-1963 prévoyant la construction d’une raffinerie de pétrole, le processus de raffinage des hydrocarbures est resté une des préoccupations de l’Etat.
Avec la création de la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), un dépôt pétrolier d’une capacité de 1200 m3 composé exclusivement de gasoil et d’essence a été construit à kamsar pour être approvisionné par un quai pétrolier situé à proximité de cette installation.
Dans le cadre de la coopération italo-guinéenne un dépôt de 2000 m3 d’essence, de gasoil et de pétrole a été construit à N’Zérékoré ; deux mini dépôts de 150 m3 chacun ont été construits à Siguiri et à Dinguiraye.
Durant la période de gestion de l’ONAH, le prix du carburant était fixé par l’Etat et les ruptures d’approvisionnement en produits pétroliers étaient fréquentes.
A l’aube de la privatisation de ce secteur, l’Etat avait réussi à créer la Société de Manutention du Carburant Aviation (SOMCAG) et la Société Guinéenne de Lubrifiants (SOGUILUBE) qui seront confiées respectivement à Total et à Shell.
A l’avènement de la 2ème République, et suite aux négociations avec les sociétés pétrolières Total, Shell et ENI puis ELF, l’Etat s’est désengagé des activités marchandes de l’économie nationale en créant avec ces compagnies la Société Guinéenne des Pétroles (SGP), conformément au protocole d’Accord du 18 mai 1990.
Cette restructuration a conduit à la liquidation-extinction de la Société Nationale (ONAH) et à la libéralisation des activités dont elle avait au paravent le monopole.
L’élaboration d’une péréquation transport a aussi permis d’approvisionner l’ensemble du territoire au même prix à la pompe.
Une première conséquence de cette privatisation est le développement du réseau de distribution sur l’ensemble du territoire par la rénovation et la construction de nouvelles stations-service.